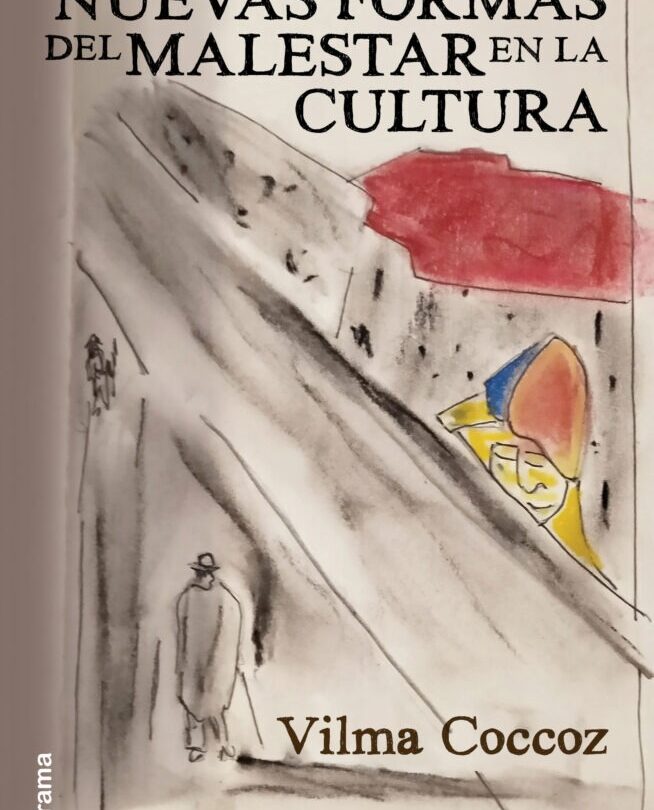Commentaire sur le livre de Vilma Coccoz, par Guy Briole
Vilma Coccoz, dans ce magnifique livre qu’elle a écrit aux Éditions Grama, marque un temps, comme un regard en point du capiton sur notre époque. C’est ainsi que je pense que cette actualisation du « Malaise dans la culture », cette œuvre majeure de Freud, était nécessaire que nous avons plutôt l’habitude de traduire en français par « Malaise dans la civilisation ».
Peut-être, pour commencer, je dirai que l’on pourrait, comme Lacan nous a enseigné à aborder une question : la prendre par son envers. Le « malaise » pour une civilisation, son existence, est certainement salutaire. Tout dépend de son degré. Cela peut paraître paradoxal, même provocateur. Comme, d’ailleurs, l’est l’entreprise que se propose Vilma quand elle annonce que ce sont de « Nouvelles formes du malaise dans la culture ». Je me suis demandé pourquoi nous proposer de « nouvelles formes » quand, très précisément, l’œuvre de Freud est intemporelle. C’est-à-dire que ce que Freud a défini du « Malaise dans la culture » reste toujours d’une grande actualité. Il en va, de même, souvent ainsi des textes de Lacan, ils gardent leur pertinence. Ceci parce que, avant tout, bien qu’étant une interprétation de leur époque, ils avaient saisi au-delà des particularités du moment, une modalité structurale qui se répète dans le temps qui passe.
Je disais donc que ce malaise est certainement ce qui peut arriver de mieux pour un peuple quand, ce malaise fait l’objet d’une dialectisation. Le « bien-être » que chacun pourrait espérer est une illusion à laquelle si on y adhère sans recul, peut conduire au pire ; à la guerre notamment. Ainsi doit-on pouvoir accepter, dans la société où l’on se déplace, un certain degré de malaise qui fait que l’on se dirige vers l’autre, que l’on puisse s’adresser à lui, le considérer comme un autre de l’altérité dont parle si bien Emmanuel Levinas.
Vilma, elle aussi s’adresse à nous. Son livre apporte singulièrement en ce sens que son contenu je le verrai plus que « Nouvelles formes », comme une « Nouvelle lecture » du malaise d’aujourd’hui. Une nouvelle lecture par le prisme du travail fait par Freud. C’est ainsi que j’ai lu le livre avec ce regard précis que pose Vilma sur notre époque. Pour cela elle prend en compte les expériences douloureuses traversées par les peuples, sans pour autant être tournée vers le passé. Elle nous transmet l’enseignement de Freud auquel elle mêle subtilement celui de Lacan.
Elle rappellera aussi opportunément, page 160, cette appréciation de Jacques-Alain Miller que nous ferons notre quand il dit que ce texte de Freud est « le texte le plus politique ». C’est dans le sens que cela dit quelque chose de fondamental de la vie des humains.
Alors, j’en avais convenu avec Vilma, je vais aller pour mon commentaire directement au chapitre la Clinique freudienne de la guerre. Pour commencer je soulignerai cette première phrase que j’ai moi-même souvent reprise et qui est centrale : « la guerre ne laisse personne indifférent ». À quoi on peut ajouter que la guerre est quelque Chose qui s’immisce partout, dans tous les liens entre toutes les nations, mais aussi dans la nation, dans les communautés et jusques au cœur des familles. Ceux de ma génération, mais aussi ceux qui ont traversé les dictatures, savent reconnaitre ce dont parle ce livre. Aujourd’hui, je l’avais dit à Vilma, nous sommes le 8 mai, c’est le jour de la commémoration de la fin de la 2nde guerre mondiale durant laquelle le génocide du peuple juif fut cette atrocité à aucune autre comparable.
J’apprécie, tout particulièrement, que Vilma précise que tout n’est pas assimilable à la guerre même si on l’utilise ce mot bien facilement aujourd’hui pour parler de la guerre des sexes, de la guerre économique, etc. En effet tout ça, ce n’est pas la guerre. Il n’y a pas de guerre sans morts, ni sans la destruction de ce qui unit les humains. La guerre détruit l’histoire des hommes comme ont pu en témoigner beaucoup de déportés de 39 45 : Ils ont été arrachés à leur histoire ;ça c’est la guerre !
Vilma, se référant à Roger Caillois, reprend ceci que que la guerre serait là comme une modalité de la civilisation, pour s’en distancier. Mais, voilà, qu’il s’agisse de guerres de pacification, de reconquête, a fortiori de colonisation, il faut bien constater que les guerres ne civilisent pas ; ce serait même plutôt tout le contraire. C’est d’ailleurs la triste constatation que font tout autant Freud qu’Einstein [p. 187] dans leurs échanges « Pourquoi la guerre ». Freud se désespère de ce que l’homme soit civilisé un jour et que les guerres ne cessent : il restera toujours cette part noire dans l’homme, marquée par la cruauté et par l’idée de la mort de l’autre, que rien ne limite dans les déchaînements de la guerre.
La Grande Guerre, celle de 14-18, une des plus grandes boucheries de l’histoire, Vilma l’aborde dans les pages 131 et suivantes. C’est à son issue que Freud, invité par Ferenczi au Congrès mondial de psychanalyse de Budapest en 1918 [p. 146], pourra évaluer l’horreur des conséquences de la guerre. C’est dans ce temps qu’il révisera, en 1920, sa théorie du trauma et qu’il écrira son Au-delà du principe de plaisir. Dans ce texte clé, le trauma n’a plus seulement le sens sexuel que Freud lui avait donné dans les premiers temps de l’invention de la psychanalyse mais il prend ici sa dimension de rencontre avec la mort et de rupture de ce qu’il appelait le pare-excitation. Toute la théorie du traumatisme sera remise en question et la clinique même que décrit Freud garde toute son actualité.
Je trouve très intéressant la manière que Vilma a de reprendre la question du lieutenant Kauder. Cela pose toute la question de la simulation en temps de guerre et des traitements inhumains telle la faradisation, qui était donc appliquée à ces soldats. Le professeur Wagner Jauregg, le plus grand neurologue de Vienne, qui avait soutenu ces pratiques, fut poursuivi devant les tribunaux pour forfaiture. Freud fut convoqué pour témoigner lors du procès et son texte est très intéressant à considérer. Freud, tout en étant clair, se garda d’accuser trop directement le professeur Wagner Jauregg. Freud se centra davantage sur des questions d’éthique médicale qui doit avant tout bénéficier au patient. Mais, comment considérer qu’un soldat simulateur voire considéré comme déserteur soit lui-même ramené au statut de patient ? À sa manière Freud, lors de ce procès, a fait un petit pas de côté.
J’ai aussi été très intéressé par ce que Vilma reprend, page 163, autour de cette identification immédiate. En effet, ce type de manifestation, n’est pas compatible une dialectique. C’est le Un qui compte et non le partage. Relativisons en soulignant que cela dépend du Un. On a pu appeler Clemenceau le père de la nation. Bien sûr, cela fait une différence considérable lorsqu’il s’agit de s’identifier à Clémenceau, ou à Pétain, dans le sillon, d’Hitler. Là, ce n’est plus l’identification au un par un au Un, mais une prise en masse dans laquelle le un par un se dissout. Et, quand on est pris dans la masse on se perd dans le déchaînement pulsionnel où se perd cette liberté d’action de chacun. Cependant, nous soutenons que ce qui ne se perd pas c’est la responsabilité individuelle.
On peut souligner que c’est quelque chose qui fut l’objet de violentes polémiques lors des procès des acteurs de l’Allemagne nazie. D’un côté, les uns indiquaient qu’ils étaient obligés d’obéir aux ordres, même les pires. Ils ne prennent pas non plus à leur charge que ceux sur lesquels ils commettaient ces atrocités étaient des semblables. Des personnes, comme le dit Primo Levi, qui étaient faits de la même étoffe qu’eux ; de l’étoffe humaine bien que leur comportement soit absolument inhumain. C’est d’ailleurs sur ce point que primo Levi, comme beaucoup d’autres déportés, parlaient de la honte. La honte que ce soient des semblables qu’ils leur fassent supporter ces horreurs. C’est tout à fait différent de la culpabilité du survivant, rejetée avec force et avec raison.
De l’autre côté, ceux qui ont donné les ordres, ceux qui étaient les idéologues du régime nazi, se défendaient en indiquant qu’ils n’avaient rien fait physiquement, ni torturé, ni tué et que leurs ordres avaient été mal interprétés. Mais enfin personne ne peut adhérer à ses thèses, ni d’un côté, ni de l’autre. Quand l’élimination d’un peuple est ainsi industriellement programmée, comme ce fut dans les camps d’extermination de l’Allemagne nazie, tous ont les mains prises dans l’horreur.
Les pages sur la Shoah sont très impressionnantes. J’ai beaucoup écrit sur ce sujet, pour des raisons personnelles donc j’ai parlé d’ailleurs dans mes témoignages d’AE, mais aussi parce que j’ai reçu en consultation à l’Hôpital militaire du Val-de-Grâce, beaucoup de juifs rentrés des camps de concentration dans les années 1975, à une époque où il n’y avait pas grand monde pour s’occuper d’eux.
Le texte de Vilma est d’une grande précision, sans aucun détournement du regard. Bien sûr je rejoins Vilma dans ce qu’elle écrit, et que j’ai moi-même souvent souligné, à partir de ce que me disaient les survivants d’Auschwitz. Pour eux le pire n’était pas la mort mais ce déchirement du temps. Il faut toujours dire et redire, non comme une commémoration, mais parce que c’est fondamental à la compréhension de ce qui s’est passé dans cette époque, que pour ceux qui ont été la visée de cette destruction systématique, que c’est un arrachement à l’histoire. Il manque des mots pour dire la Shoah, car il n’y a pas de mots parler cet arrachement à l’histoire quand on se retrouve hors de l’histoire. Il est difficile en effet d’y retourner, de s’y inclure, une fois encore [p. 174].
L’inhumain ne vous laisse pas en paix. Quand vous avez été réduit au déchet, que plus rien ne vous humanisait. Je fus impressionné par le récit sur Bobby, ce chien que rencontre Emmanuel Levinas dans un camp de l’Allemagne nazie et qui venait les retrouver à tous les rassemblements du matin, puis les attendait à leur retour de la journée de travail, manifestant, à sa manière, sa joie de les revoir. « Pour lui, écrit Levinas, – c’était incontestable – nous fûmes toujours des hommes »[1].
Le chapitre suivant qui s’appelle « Mémoire et transmission » est aussi fondamental. On a beaucoup parlé du devoir de mémoire. Mais au fond ce devoir de mémoire c’est ce qui enferme celui qui a été dans les camps à ne pouvoir être que ce témoin. Cela ne facilite pas non plus qu’il se libère de cette place. C’est ici que l’on fait retourner sur lui la culpabilité : « tu dois au moins ça ». En effet, “devoir de mémoire” ce n’est pas la même chose que la “nécessité éthique de la transmission”.
Le sous-chapitre, « Mémoire et savoir », est tout autant à considérer. Voilà un Chapitre important. Je comprends bien ce que Vilma reprenne ce que dit Anaëlle Leibovits concernant les négationnistes “oublier l’oubli”, il faut y mettre du sien pour soutenir cette position. Avec Anaëlle, vous développez ce qu’est une mémoire séparée de l’affect ; alors on appellerait ça la “mémoire historique”. La “Mémoire historique” ce n’est pas non plus la vérité. Car, c’est alors que commence la discussion des historiens, leurs accords et leurs désaccords. Je soutiendrai que la mémoire n’appartient à personne et que, d’une certaine manière, c’est la responsabilité de chacun. Néanmoins, Simone Weil [p. 193] soutenait, comme c’est repris dans le livre, que « l’on ne peut obliger personne à se souvenir ». D’autant plus que l’on a très vite fait de mettre celui qui va témoigner du côté des victimes. De plus, des victimes directes, il y en a de moins en moins. Il n’est pas non plus évident de reprendre le flambeau uniquement au titre d’être enfants de victimes ou de la famille de victimes. En fait, de mon point de vus, pour ce qu’il en est de la Shoah c’est une question pour tout le monde. Ce n’est pas qu’une question de spécialistes. Mais voilà, quand on dit tout le monde, il se trouve qu’il reste à savoir ce que l’on retient de l’Histoire et, là, c’est une autre affaire.
Plus précisément relativement au « savoir » dont parle Vilma, le premier point c’est celui que nous connaissons bien en psychanalyse : dans ce qui a été transmis et qui a pu être remanié, amplifié, amputé ; il reste ce que chacun veut savoir et de ce qu’il ne veut pas savoir.
De toute cette mémoire, qui l’implique comme elle concerne la mémoire collective du groupe social qui l’entoure, il fait son histoire. Il lui arrive de faire porter à d’autres, aux autres, la part qui lui en revient.
Les sociétés savent cela ; elles ont constitué des lieux du souvenir : monuments, musées, mémorial… Les noms sont gravés dans le marbre pour que, au-delà de l’effacement, perdure le souvenir : celui qui inscrit les hommes dans une histoire, une aventure, une époque, un collectif… Mais les hommes étant ce qu’ils sont, ils restent tentés par l’effacement. Au regard de son propre narcissisme, l’homme est oublieux. Il peut l’être de ce qui lui a été transmis, ne retenant que ce qui le fait porteur du savoir qu’il s’est constitué comme vérité.
Le devoir de mémoire, pour indispensable qu’il soit, laisse dans l’ombre une grande part d’un indicible dont les sociétés se sont arrangées : honorer la mémoire sans avoir à écouter l’impensable.
C’est ainsi que je comprends la thèse que le livre de Vilma soutient : le devoir de connaissance implique un travail —travail de mémoire que ne recouvre pas le travail historique— qui ouvre à une approche éthique par une remise en cause des croisements de l’histoire personnelle et de l’histoire collective.
Enfin, le livre de Vilma contient bien des choses jusqu’à une approche d’une clinique de l’autisme où, dans le malaise actuel des sociétés, l’on voudrait maintenir les psychanalystes éloignés. On trouvera aussi une réflexion sur les psychoses ordinaires, la souffrance au travail. Sur ce dernier point il se démontre qu’il ne suffit pas de se plaindre mais, comme le soutient dit Jacques-Alain Miller, dans un texte que je lisais récemment pour une future publication, il faut prendre position. Il ne s’agit pas de se rendre à la réalité mais, tout au contraire, de « forcer la réalité à nous reconnaître » C’est une belle leçon.
Eh bien, je trouve qu’il y a quelque chose dans ton livre qui est de cet ordre-là. C’est remarquable.
Pour terminer je voudrais remercier chaleureusement et féliciter Vilma. Il y aurait mille autres choses à dire.
Je voudrais aussi féliciter Alexandra Glaze, la directrice de la collection Grama, d’avoir promu ce livre et de l’avoir fait si beau. L’image et le design de cette couverture est remarquable. On a plaisir à prendre le livre en main, à le regarder, à l’ouvrir et, bien sûr et surtout, à le lire.
Un grand bravo Vilma et à tous ceux qui l’ont inspirée, soutenue et accompagnée. Nous avons essayé de le faire aujourd’hui, a posteriori, mais pour demain.
[1] Levinas E., « Nom d’un chien ou le droit naturel », Difficile liberté, Paris, Le livre de poche, 1984, p. 234.